
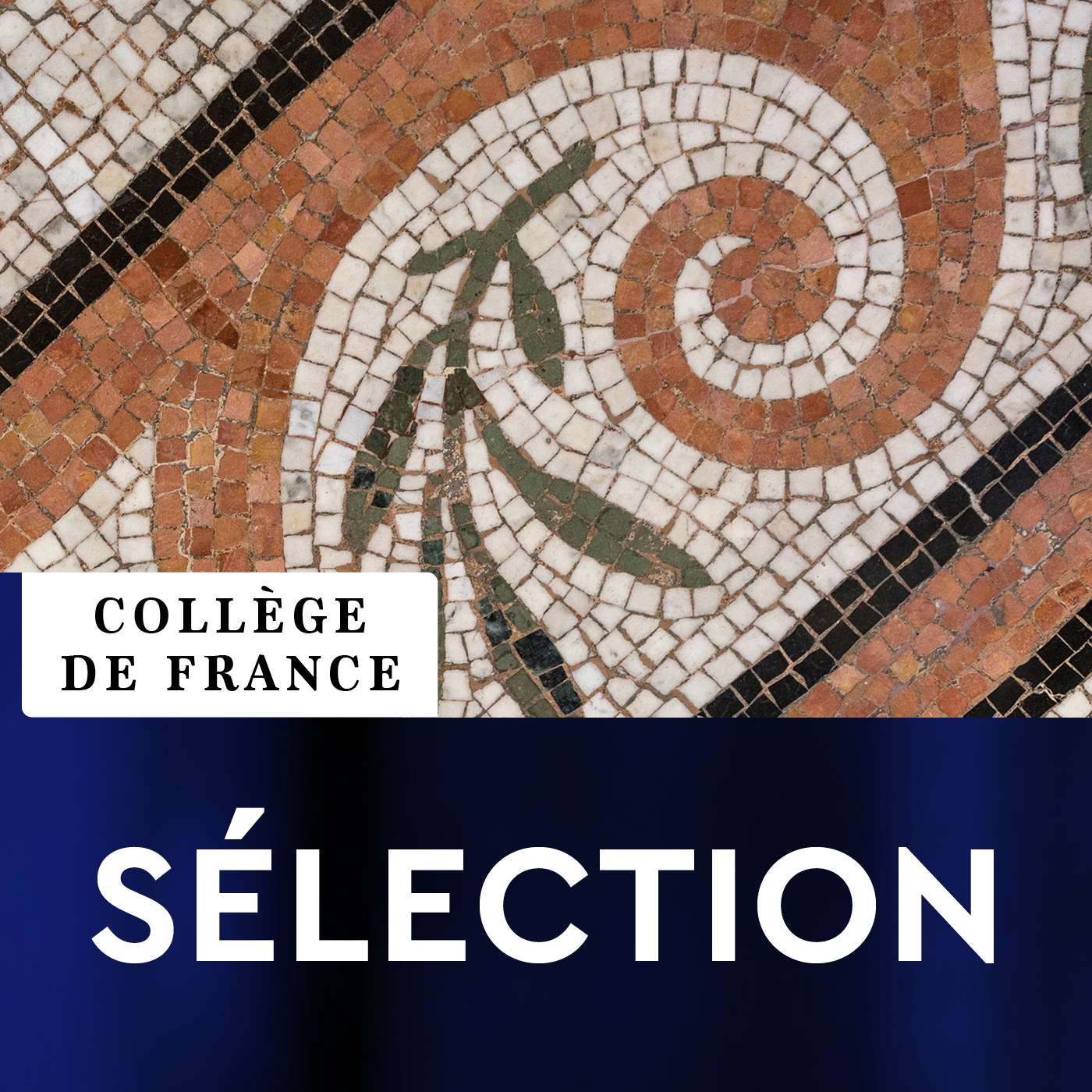
Collège de France - Sélection
Collège de France
Une sélection des enseignements et conférences du Collège de France. Retrouvez l’ensemble des podcasts du Collège de France par professeur sur notre site internet.
Episodes
Mentioned books

Nov 20, 2003 • 1h 2min
Leçon inaugurale - Jayant Vishnu Narlikar : Faits et spéculations en Cosmologie
Jayant Vishnu Narlikar Chaire annuelle Internationale (2002-2003) Collège de France Leçon inaugurale - Jayant Vishnu Narlikar : Faits et spéculations en Cosmologie Date : 20 novembre 2003 Résumé Après avoir présenté une vision historique des efforts de l'homme pour comprendre l'Univers, la seconde partie de cette leçon passe en revue les aspects factuels et spéculatifs de la cosmologie moderne. Cette leçon commence par une description de l'histoire des essais entrepris par l'homme pour comprendre l'Univers. Les anciennes civilisations avaient leurs mythologies, entièrement spéculatives. Au fur et à mesure des progrès de la science, on a ressenti de plus en plus le besoin d'appuyer les spéculations sur des faits d'observation. Ainsi des théories hautement hypothétiques (comme l'anti-Terre des pythagoriciens, les orbites circulaires aristotéliciennes, ou les épicycles ptolémaïques) ont dû être abandonnées, parce qu'elles étaient contredites par les faits d'observation, de plus en plus nombreux, du fait de l'amélioration des techniques. Un pas majeur dans la compréhension du cosmos a été fait au XVIIe siècle, avec la loi newtonienne de la gravitation. Bien que son point de départ ait été très intuitif, très spéculatif, plusieurs de ses applications à l'Univers ont été des succès, et ont assis sa crédibilité, en tant que théorie scientifique. Ainsi a-t-elle expliqué les mouvements de la Lune et des planètes, a-t-elle permis de prévoir le passage de la comète dite aujourd'hui de Halley, de découvrir la planète Neptune, etc. Un autre exemple de succès en astrophysique est la théorie de la structure interne des étoiles et de leur évolution, qui explique les propriétés observées des étoiles, ainsi que cela a été maintes fois vérifié. En vérité, une théorie scientifique doit, pour être acceptable, avoir subi des vérifications répétées de ses prévisions. Comment la cosmologie moderne se comporte-t-elle face à une telle épreuve ? La cosmologie moderne date réellement de 1929, et de la découverte par Edwin Hubble de l'expansion de l'Univers. Mais, quelques années auparavant, Alexandre Friedmann avait proposé des modèles d'Univers, qui expliquaient une telle expansion, et qui conduisirent à la conclusion que l'Univers avait trouvé son origine dans une explosion gigantesque, ce qu'on appelle le « Big Bang ». Dans les années 40, George Gamow et ses jeunes collègues, Ralph Alpher et Robert Herman avaient extrapolé les modèles de Friedmann vers les époques les plus anciennes, alors que l'Univers était extrêmement chaud et en très rapide expansion. Ils ont pu expliquer l'origine des éléments légers trouvés dans l'Univers, synthétisés dans les quelques 2 à 3 minutes après le big bang. Alpher et Herman ont aussi prédit l'existence d'un rayonnement fossile de fond de ciel, signature en quelque sorte de cette époque extrêmement chaude. Un tel rayonnement a de fait été découvert ensuite en 1965. Ces travaux peuvent être vus comme des succès essentiels de cette cosmologie et lui ont conféré une incontestable crédibilité. Les travaux ultérieurs se sont concentrés sur l'étude de l'Univers des premiers instants, remontant à une… micro-micro-micro-micro-micro-micro seconde après le big bang. À ces époques, la nature de la physique est inconnue, et invérifiable. L'Univers lui-même ne peut être observé directement par les méthodes de l'astronomie. De plus les évènements supposés avoir alors eu lieu ne peuvent être répétés. Si bien que la prétention d'avoir obtenu quelque succès dans ces récentes recherches repose seulement sur un certain nombre d'hypothèses très spéculatives, qui ne peuvent qu'à grande peine satisfaire aux exigences que l'on est en droit d'imposer à une théorie scientifique.

May 22, 2003 • 59min
Leçon inaugurale - Pierre-Louis Lions : Équations aux dérivées partielles et applications
Pierre-Louis Lions Chaire Équations aux dérivées partielles et applications Collège de France Leçon inaugurale - Pierre-Louis Lions : Équations aux dérivées partielles et applications Date : 22 mai 2003 Résumé En quelques décennies, les simulations numériques sont devenues un outil privilégié dans de nombreux domaines scientifiques (physique, chimie, mécanique, météorologie, sciences de l'ingénieur, finance) et secteurs industriels (aéronautique, spatial, automobile, nucléaire, etc.). Elles ont pour but de reproduire par le calcul le comportement d'un système décrit par un modèle, très souvent constitué d'équations aux dérivées partielles. Une simulation numérique consiste à « résoudre ces équations » grâce aux ordinateurs.

Feb 27, 2003 • 48min
Leçon inaugurale - Stuart Edelstein : Les mécanismes de la transduction du signal en biologie
Stuart Edelstein Chaire annuelle Internationale (2002-2003) Collège de France Leçon inaugurale : Les mécanismes de la transduction du signal en biologie Date : 27 février 2003 Résumé « Mes recherches ont souvent touché à la génétique humaine et comme tous les chercheurs dans ce domaine, je suis très impressionné par le séquençage récent de notre patrimoine génétique. Aujourd'hui marque exactement cinquante ans depuis la découverte de la double hélice par Watson et Crick. Les 2,9 milliards de paires de bases sont maintenant largement déchiffrés et ont révélés quelques 31 000 gènes. On peut concevoir cette information comme la vaste partition d'un orchestre de 31 000 instruments qui jouent sans chef, ni musiciens. Chaque instrument se met à jouer lorsqu'il reçoit un signal, au moment approprié, venu d'un autre instrument. Quand les instruments jouent ainsi en harmonie, une biologie joyeuse est perçue. Les dissonances, en revanche, sont à l'origine de troubles pathologiques. Comme pour cet orchestre virtuel, la vie à tous les niveaux dépend de la réception de signaux et de leur transduction en actions physiologiques. Les biologistes n'ont pas encore compris dans tous les détails les mécanismes de la transduction du signal, mais plusieurs principes clés ont été dégagés… » Stuart Edelstein

Jan 20, 2003 • 53min
Leçon inaugurale - Mireille Delmas-Marty : Études juridiques comparatives et internationalisation du droit
Mireille Delmas-Marty Études juridiques comparatives et internationalisation du droit (2003-2011) Collège de France Année 2002-2003 Leçon inaugurale - Mireille Delmas-Marty : Études juridiques comparatives et internationalisation du droit Date : 20 janvier 2003 Résumé En associant une méthode – les études comparatives – à un processus en cours – l'internationalisation du droit –, cette chaire s'inscrit dans l'avenir, si incertain soit-il. Certes les événements présents soulignent tragiquement l'absence d'un véritable ordre juridique mondial : le système de sécurité collective de la Charte des Nations unies a montré sa fragilité et le droit n'a pas su désarmer la force. Mais à l'inverse la force ne peut empêcher cette extension du droit, sans précédent dans l'histoire, au point qu'aucun État ne saurait durablement s'en affranchir. Il n'est plus possible aujourd'hui de méconnaître la superposition de normes – nationales, régionales et mondiales –, ni la surabondance d'institutions et de juges – nationaux et internationaux –, à compétence élargie. Ces réalités nouvelles font évoluer le droit vers des systèmes interactifs, complexes et fortement instables. Plus que d'une défaite du droit, c'est peut-être d'une mutation qu'il s'agit, une mutation de la conception même de l'ordre juridique.

Nov 7, 2002 • 40min
Leçon inaugurale - Edouard Bard : Évolution du climat et de l'océan
Edouard BardCollège de FranceChaire Évolution du climat et de l'océanAnnée 2021-2022Leçon inaugurale : Évolution du climat et de l'océanDate : 7 novembre 2002RésuméPrononcée en 2002 à l'occasion de l'ouverture de la chaire Évolution du climat et des océans, la leçon inaugurale d'Edouard Bard n'a rien perdu de son actualité. Elle nous rappelle que le réchauffement climatique est une préoccupation de longue date d'une partie de la communauté scientifique, qui disposait déjà depuis des décennies de données nombreuses et étayées. À travers une description de l'histoire du climat, l'auteur croise les approches complémentaires de la paléoclimatologie, de l'océanographie et de la géologie pour mieux analyser et contextualiser le réchauffement global que subissent aujourd'hui le climat et les océans. Ce texte précurseur résonne comme un avertissement qui vient faire écho aux préoccupations contemporaines face aux grands enjeux climatiques de notre époque.

Oct 10, 2002 • 57min
Leçon inaugurale - Christine Petit : Génétique et physiologie cellulaire
Christine Petit Chaire Génétique et physiologie cellulaire (2001-2020) Collège de France Leçon inaugurale : Génétique et physiologie cellulaire Date : 10 octobre 2002 Résumé La physiologie du système auditif, en particulier celle des premiers relais de traitement des signaux sonores, est assez bien comprise. En revanche, les mécanismes cellulaires et moléculaires qui la sous-tendent échappaient encore à toute caractérisation, au début des années 1990. L'approche génétique que le laboratoire de la Professeure Christine Petit en proposa, a permis d'en initier le déchiffrage. Cette recherche adossée à l'identification des gènes dont l'atteinte est responsable de formes précoces de surdité chez l'homme, se développe sous la forme d'études multidisciplinaires. Elle éclaire les bases moléculaires de la formation et du fonctionnement de l'organe sensoriel auditif, notamment de ses cellules sensorielles ainsi que la pathogénie d'un vaste ensemble de surdités héréditaires du sujet jeune. Elle est aussi à l'origine de la découverte de nouvelles propriétés physiologiques du système auditif. L'objectif de la recherche s'est élargi depuis peu à l'élucidation de la pathogénie de la presbyacousie, surdité neurosensorielle liée à l'âge, et à une approche thérapeutique du syndrome Usher. Les cours de Christine Petit portent sur le système auditif, son fonctionnement et ses dysfonctionnements.

Mar 28, 2002 • 58min
Leçon inaugurale - Pierre Rosanvallon : Histoire moderne et contemporaine du politique
Pierre Rosanvallon Chaire Histoire moderne et contemporaine du politique (2001-2018) Collège de France Année 2001-2002 Leçon inaugurale - Pierre Rosanvallon : Histoire moderne et contemporaine du politique Date : 28 mars 2002 Résumé Mon ambition est de penser la démocratie en reprenant le fil de son histoire. Mais il est tout de suite nécessaire de préciser qu'il ne s'agit pas seulement de dire que la démocratie a une histoire. Il faut considérer plus radicalement que la démocratie est une histoire. L'objet de l'histoire conceptuelle du politique est ainsi de suivre le fil des expériences et des tâtonnements, des conflits et des controverses, à travers lesquels la cité a cherché à prendre forme légitime. En retraçant la généalogie longue des questions politiques contemporaines, il s'agit de reconstruire la façon dont des individus et des groupes ont élaboré leur intelligence des situations, de repérer les récusations et les attractions à partir desquelles ils ont formulé leurs objectifs, de retracer la manière dont leur vision du monde a borné et organisé le champ de leurs actions. C'est pour cela une histoire qui a pour fonction de restituer des problèmes plus que de décrire des modèles. L'histoire ainsi conçue est le laboratoire en activité de notre présent, et non pas seulement l'éclairage de son arrière-fond. L'attention aux problèmes contemporains les plus brûlants et les plus pressants ne peut se dissocier pour cette raison d'une méticuleuse reconstruction de leur genèse.

Mar 14, 2002 • 1h
Leçon inaugurale - Roland Recht : Histoire de l'art européen médiéval et moderne
Roland Recht Chaire Histoire de l'art européen médiéval et moderne (2001-2012)Collège de France Leçon inaugurale - Roland Recht : Histoire de l'art européen médiéval et moderne Date : 14 mars 2002

Feb 7, 2002 • 55min
Leçon inaugurale - John Scheid : Religion, institutions et société de la Rome antique
John Scheid Chaire Religion, institutions et société de la Rome antique (2001-2016) Collège de France Leçon inaugurale - John Scheid : Religion, institutions et société de la Rome antique Date : 7 février 2002 Résumé En opposant aux discours sectaires les armes universelles de l'histoire, de la philologie et de l'anthropologie, bref tout l'arsenal de la science et de la raison, l'histoire des religions du passé nous met en mesure de dégonfler les mythes modernes, ceux des autres, mais également les nôtres. Elle permet de repérer la projection dans le passé imaginaire des « origines » de fantasmes nationalistes, religieux ou racistes, et de désarmer les interprétations outrées qui peuvent être faites des textes sacrés. À l'intérieur des nations héritées du XIXe siècle, l'histoire ancienne peut aider à déconstruire la représentation que les États-nations se font parfois de leur passé, en montrant que malgré leur apparente proximité, leurs « ancêtres » sont aussi éloignés de la société actuelle que les habitants des antipodes. Elle permet de contester le « miracle grec », le « génie romain », la « supériorité germanique », ou encore la dialectique hégélienne selon laquelle les religions et l'histoire tendent vers le monothéisme chrétien.

Jan 17, 2002 • 52min
Leçon inaugurale - Jacques Livage : Chimie de la matière condensée
Jacques Livage Chaire Chimie de la matière condensée (2001-2009) Collège de France Leçon inaugurale : Chimie de la matière condensée Date : 17 janvier 2002 Résumé Chimiste du solide, Jacques Livage a été à l'origine du développement de la chimie douce dans le domaine des matériaux. Inspirée des processus de biominéralisation, cette nouvelle méthode de synthèse a conduit au développement des « procédés sol-gel » qui permettent d'élaborer des verres et des céramiques dans des conditions proches de l'ambiante. Contrairement aux techniques classiques de la chimie du solide qui font réagir des poudres en les chauffant à haute température, la chimie douce utilise des précurseurs moléculaires en solution. Le réseau solide est formé progressivement via des réactions de polycondensation analogues à celles qui sont mises en jeu pour la synthèse des polymères organiques. Ces conditions de « chimie douce » permettent de faire réagir simultanément des molécules organiques et des espèces minérales, conduisant à la formation d'hybrides organo-minéraux. Ces nanocomposites à l'échelle moléculaire ouvrent la voie à toute une gamme de matériaux nouveaux alliant les propriétés des verres à celles des polymères. Jacques Livage consacre maintenant l'essentiel de ses travaux à l'application des méthodes sol-gel dans le domaine de la biologie. La chimie douce permet en effet d'immobiliser des espèces biologiques (enzymes, anticorps, bactéries, virus, micro-algues...) au sein de matrices minérales. Les espèces immobilisées conservent leur activité biologique permettant de réaliser des biocapteurs et des bioréacteurs.


