
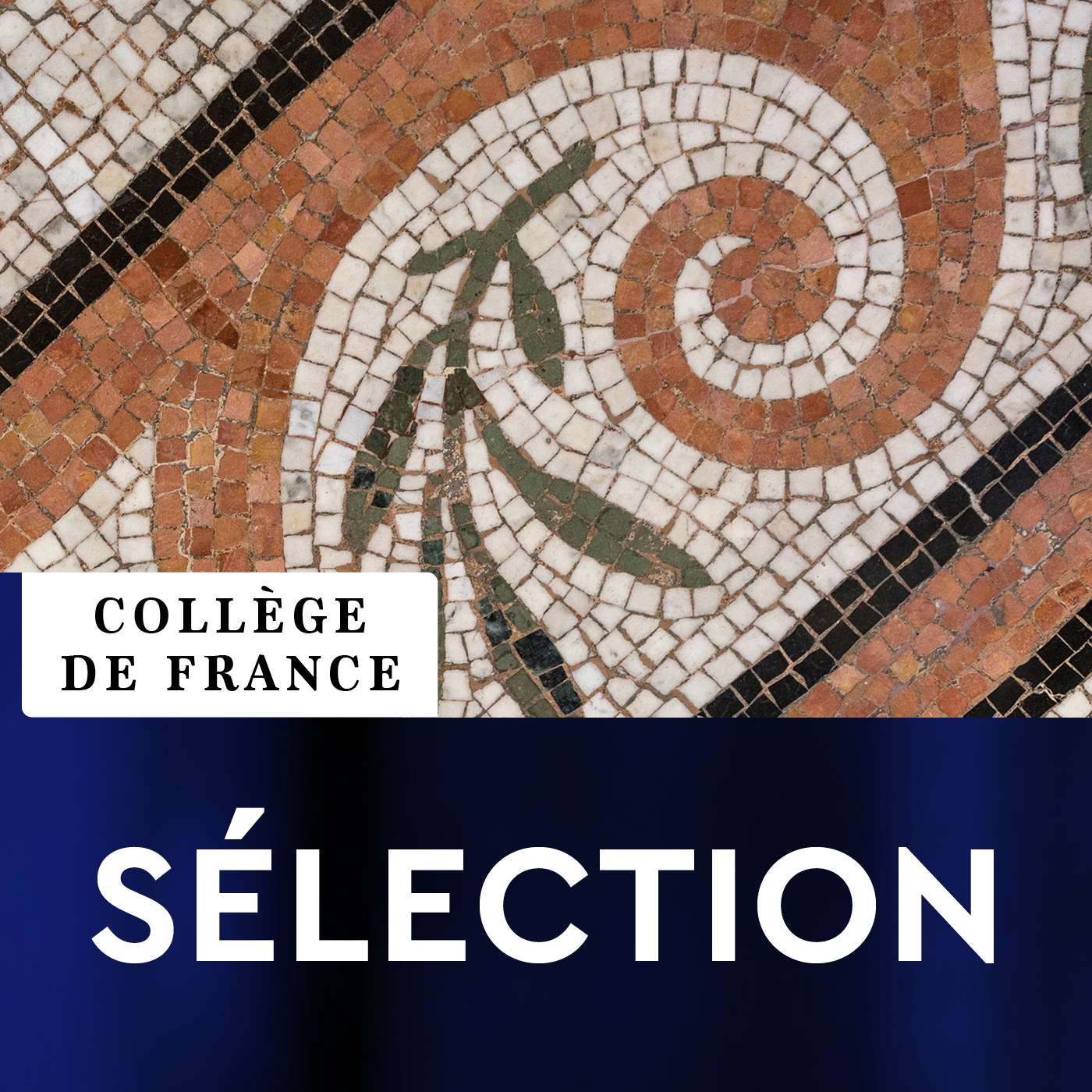
Collège de France - Sélection
Collège de France
Une sélection des enseignements et conférences du Collège de France. Retrouvez l’ensemble des podcasts du Collège de France par professeur sur notre site internet.
Episodes
Mentioned books

Apr 6, 2006 • 54min
Leçon inaugurale - Thomas Pavel : Comment écouter la littérature ?
Thomas Pavel Chaire internationale (2005-2006) Collège de France Leçon inaugurale : Comment écouter la littérature ? Date : 6 avril 2006 Résumé Ce projet prend pour objet l'ensemble des liens qui rattachent la littérature d'imagination à l'ensemble de nos préoccupations morales. En abordant cette thématique, déjà explorée par les travaux de Jacques Bouveresse et de Michel Zink, je souhaite me pencher en particulier sur la manière dont la littérature d'imagination met en valeur une dimension essentielle de la vie en commun, qui est celle de la difficulté que les êtres humains ont à se frayer une voie parmi le foisonnement des exigences éthiques. Mon point de départ, d'une grande simplicité, consiste à soutenir que la littérature d'imagination nous propose une multitude de cas individuels destinés à éclairer les difficultés de la pratique morale. L'œuvre littéraire accomplit cette tâche en exerçant sur nous une double action : poétique d'un côté, et fictionnelle de l'autre. La force de la poésie nous libère des nos attaches empiriques immédiates ; la poésie nous transporte. La fiction, quant à elle, nous installe ailleurs, au sein des mondes qu'elle évoque. Ces deux opérations sont complémentaires car, en nous arrachant à nos soucis quotidiens, l'exaltation poétique facilite notre immersion imaginaire dans les univers fictionnels.

Feb 23, 2006 • 49min
Leçon inaugurale - Maurice Bloch : L'anthropologie cognitive à l'épreuve du terrain
Maurice Bloch Chaire annuelle Européenne (2005-2006) Collège de France Leçon inaugurale : L'anthropologie cognitive à l'épreuve du terrain Date : 23 février 2006 Résumé Traditionnellement, les anthropologues mènent deux entreprises qui ne semblent pas avoir beaucoup en commun. D'une part, ils étudient de manière extrêmement minutieuse des petits groupes d'individus, souvent assez isolés des grands centres de la mondialisation, dont ils s'efforcent d'interpréter la conception du monde ou l'organisation sociale. D'autre part, ils échafaudent des théories générales concernant les comportements et les manières de penser de l'humanité dans sa globalité. Comment ces deux types d'activités peuvent-elles être reliées et dans quel but ? Il semble que la majorité des anthropologues contemporains considère comme peu intéressant le type d'approche visant à réunir ces deux pratiques puisqu'ils se livrent entièrement et exclusivement à l'une ou l'autre d'entre elles. Ainsi les départements universitaires d'anthropologie de par le monde sont-ils de plus en plus dominés par une ethnographie ayant abandonné toute ambition théorique générale. Par conséquent, les théoriciens se trouvent plus à l'aise en dehors des départements d'anthropologie classiques. Le problème se pose d'une manière particulièrement aiguë pour l'anthropologie cognitive car elle emprunte beaucoup de ses idées à des disciplines issues des sciences cognitives qui n'hésitent pas à généraliser au niveau de l'espèce. En revanche, elles ne s'intéressent que de manière anecdotique à des cas particuliers situés dans le temps et l'espace. Dans cette leçon inaugurale, Maurice Bloch propose de garder, à l'instar d'anthropologues comme Bronislaw Malinowski, Claude Lévi-Strauss ou Françoise Héritier, un pied dans chacune de ces deux entreprises. Ce n'est qu'ainsi, pense-t-il, que l'anthropologie est en mesure d'apporter une contribution originale et enrichissante aux autres disciplines des sciences humaines. Aussi a-t-il entrepris récemment un nouveau type de recherche dans le petit village de la forêt orientale malgache où il travaille depuis maintenant plus de trente ans. Utilisant des tests de psychologie cognitive développés à l'origine aux États-Unis, il a cherché à comparer de manière rigoureuse le développement cognitif des enfants malgaches avec celui des enfants américains testés au préalable par des collègues psychologues. Cependant, lors de son dernier séjour, en 2004, au lieu d'importer une grille d'interprétation développée par les scientifiques, il a demandé aux villageois d'interpréter eux-mêmes les résultats des expériences. Le test utilisé, dit test de « fausse croyance », avait eu une grande importance pour les théories récentes sur le développement chez les enfants de la compréhension de la nature du monde social. Ce test avait pour but de mettre en évidence le fait que les adultes agissent en termes non pas de la nature du monde mais de ce qu'ils croient être la nature du monde, et qu'ils le savent. Cette connaissance est essentielle pour vivre en société. Les enfants malgaches se sont comportés dans ces tests de manière similaire aux enfants américains ou européens, ce qui était attendu, mais le point central était l'observation de la manière dont les villageois interpréteraient la différence entre les très jeunes enfants, qui ne comprennent pas encore que les gens agissent selon ce qu'ils croient, et les enfants plus âgés, qui ont intégré cette réalité. Ce travail récent de Maurice Bloch a montré que les adultes malgaches comprennent cette étape essentielle du développement des enfants d'une manière étonnamment proche, sans lui être toutefois identique, de celle des scientifiques occidentaux. De ces observations, Maurice Bloch tire un certain nombre de conclusions qui seront exposées dans ce cycle de leçons. Le premier constat est que ce que les psychologues ont révélé par leurs expériences est plus proche du sens commun qu'on ne l'a souvent prétendu, et que, de ce fait, la théorie de l'esprit, nécessaire à la vie sociale, se situe à la frontière du conscient et du non conscient. Deuxième constat : ces données mettent en doute certaines théories anthropologiques, dues entre autres à Marcel Mauss, sur la nature culturelle de la notion de personne. Troisième constat : ces résultats permettent de revoir la relation entre l'ethnographie de terrain et la théorie généralisante.

Feb 2, 2006 • 1h 8min
Leçon inaugurale - Christian de Portzamparc : Architecture : figures du monde, figures du temps
Christian de PortzamparcChaire annuelle Création artistique (2005-2006) Collège de France Leçon inaugurale : Architecture : figures du monde, figures du tempsDate : 2 février 2006 « Je suis étonné que dans le monde d'aujourd'hui l'idée même d'architecture survive. Les plans d'une grande part de ce qui se construit dans le monde depuis cinquante ans sont faits par des bureaux techniques où il n'y a pas à proprement parler d'architecte, au sens de celui qui se porte responsable devant la collectivité et l'esprit du temps. Une architecture est une petite utopie qui s'est réalisée, un morceau de futur qui est advenu aujourd'hui, à une époque où il n'y a pas de doctrine qui donne forme au temps. » Christian de Portzamparc

Feb 10, 2005 • 43min
Leçon inaugurale - Sandro Stringari : L'aventure des gaz ultra-froids. Condensation de Bose-Einstein et superfluidité
Sandro Stringari Chaire annuelle Européenne (2004-2005) Collège de France Leçon inaugurale - Sandro Stringari : L'aventure des gaz ultra-froids. Condensation de Bose-Einstein et superfluidité Date : 10 février 2005 Résumé À très basse température, le mouvement des atomes ne peut plus être décrit par les lois classiques de la mécanique newtonienne, mais suit plutôt celles de la mécanique quantique. Les atomes de certains gaz perdent alors leur identité. Ainsi, dans la condensation de Bose-Einstein (théoriquement prédite dès 1925, mais réalisée expérimentalement en 1995 seulement), les ondes des atomes se fondent dans une seule onde géante de matière et le système se comporte comme la lumière dans un faisceau laser. La superfluidité se manifeste par la disparition de la viscosité.

Nov 18, 2004 • 51min
Leçon inaugurale - Celâl Sengör : L'Histoire d'une science est la science elle-même : le cas de la tectonique
Celâl Sengör Chaire annuelle Internationale (2004-2005) Collège de France Leçon inaugurale - Celâl Sengör : L'Histoire d'une science est la science elle-même : le cas de la tectonique Date : 18 novembre 2004 Résumé Toute l'histoire de la tectonique – cette branche de la géologie qui étudie la structure et l?évolution structurelle de la couverture rocheuse de la Terre – est celle du conflit entre deux « écoles » de pensée, guidées chacune par une « image directrice » : l'école « catastrophiste » qui croit en un univers régulier et déterministe à comportement catastrophiste ; et l'école « uniformitariste » qui croit en un univers irrégulier (et en principe indéterministe) au comportement uniforme. Cette histoire est ici contée « à rebours », du XXe siècle aux présocratiques.

May 13, 2004 • 1h 11min
Leçon inaugurale - Jean-Louis Mandel : Gènes et maladies : les domaines de la génétique humaine
Jean-Louis Mandel Chaire Génétique humaine (2003-2016) Collège de France Leçon inaugurale : Gènes et maladies : les domaines de la génétique humaine Date : 13 mai 2004 Résumé La génétique humaine analyse la contribution des gènes aux questions fondamentales « D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? ». C'est également une discipline médicale qui veut contribuer à prévenir ou traiter les maladies dont les causes résident au moins partiellement dans les variations individuelles de la séquence des gènes, notamment celles dont les mutations dans un seul gène sont la cause première, maladies individuellement rares, mais dont l'impact cumulé est majeur en termes de handicaps physiques, sensoriels et mentaux, et de mortalité précoce.

Apr 4, 2004 • 1h 14min
Leçon inaugurale - Denis Knoepfler : Épigraphie et histoire des cités grecques
Denis Knoepfler Chaire Épigraphie et histoire des cités grecques (2003-2014) Collège de France Leçon inaugurale : Épigraphie et histoire des cités grecques Date : 4 avril 2004 Résumé L'épigraphie – ou étude des inscriptions – n'est pas une simple science auxiliaire que l'historien appellerait à la rescousse faute de mieux, mais une des sources vives de l'histoire ancienne. Si les découvertes en ce domaine viennent enrichir prioritairement l'histoire des institutions civiles et religieuses, il ne faudrait surtout pas croire qu'elles ne contribuent en rien à combler les énormes lacunes de l'histoire politique, économique et sociale. Et rien ne serait plus faux que d'imaginer que l'épigraphie n'a plus rien à apporter quand il s'agit de grandes cités comme Sparte, Thèbes et surtout Athènes.

Mar 11, 2004 • 52min
Leçon inaugurale - Henry Laurens : Histoire du monde arabe contemporain
Henry Laurens Chaire Histoire contemporaine du monde arabe Collège de France Leçon inaugurale : Histoire du monde arabe contemporain Date : 11 mars 2004 Résumé Il y a plus d'un quart de siècle, alors que jeune chercheur je commençais mon travail sur les sociétés arabes contemporaines, faisait rage la controverse, relancée par Edward Said, sur la façon dont l'Occident avait créé dans des buts impérialistes la notion d'Orient. La domination imposée de l'extérieur serait relayée par un discours faisant des sociétés arabes et musulmanes des entités figées dans leur essence, dont le seul devenir positif nécessitait une intervention extérieure bénévolente chargée de les remettre dans le bon sens d'une évolution historique définie par d'autres. Il en était ainsi des disciplines à prétention scientifique comme de l'ensemble des représentations littéraires et artistiques concernant l'Orient.

Jan 15, 2004 • 1h 4min
Leçon inaugurale - Theodor Berchem : Tradition et progrès. La mission de l'Université
Theodor Berchem Chaire annuelle Européenne (2003-2004) Collège de France Leçon inaugurale : Tradition et progrès. La mission de l'Université Date : 15 janvier 2004 Résumé L'avenir de l'université a été, dès la création des premiers établissements au XIIe siècle, un sujet d'actualité qui a eu par la suite des conjonctures différentes. Depuis plusieurs années, on assiste à des impulsions importantes et nouvelles. D'une part, il s'agit de faire face aux changements fondamentaux intervenus suite aux événements de 1968 c'est-à-dire ouverture, démocratisation, université de masse… selon les interprétations des uns et des autres. D'autre part, l'internationalisation, notamment la comparaison internationale mais aussi la concurrence internationale, oriente les débats sur l'avenir de l'université.

Dec 11, 2003 • 57min
Leçon inaugurale - Michael Edwards : Étude de la création littéraire en langue anglaise
Michael Edwards Chaire Étude de la création littéraire en langue anglaise (2001-2008) Collège de France Leçon inaugurale : Étude de la création littéraire en langue anglaise Date : 11 décembre 2003 Résumé « Comme vous le savez, le projet directeur de la chaire est l'étude de la création littéraire. Cette approche est celle qui me vient spontanément, comme elle peut venir à qui, écrivant poèmes ou proses, est amené à s'interroger sur la source de ses écrits, sur les rapports les plus secrets entre sa vie et son œuvre, sur la modalité souvent énigmatique de son acte d'écrire, sur ce qui lui arrive et sur ce qui arrive au monde dès qu'il entre dans le domaine légèrement autre d'une parole en formation… » Michael Edwards


