
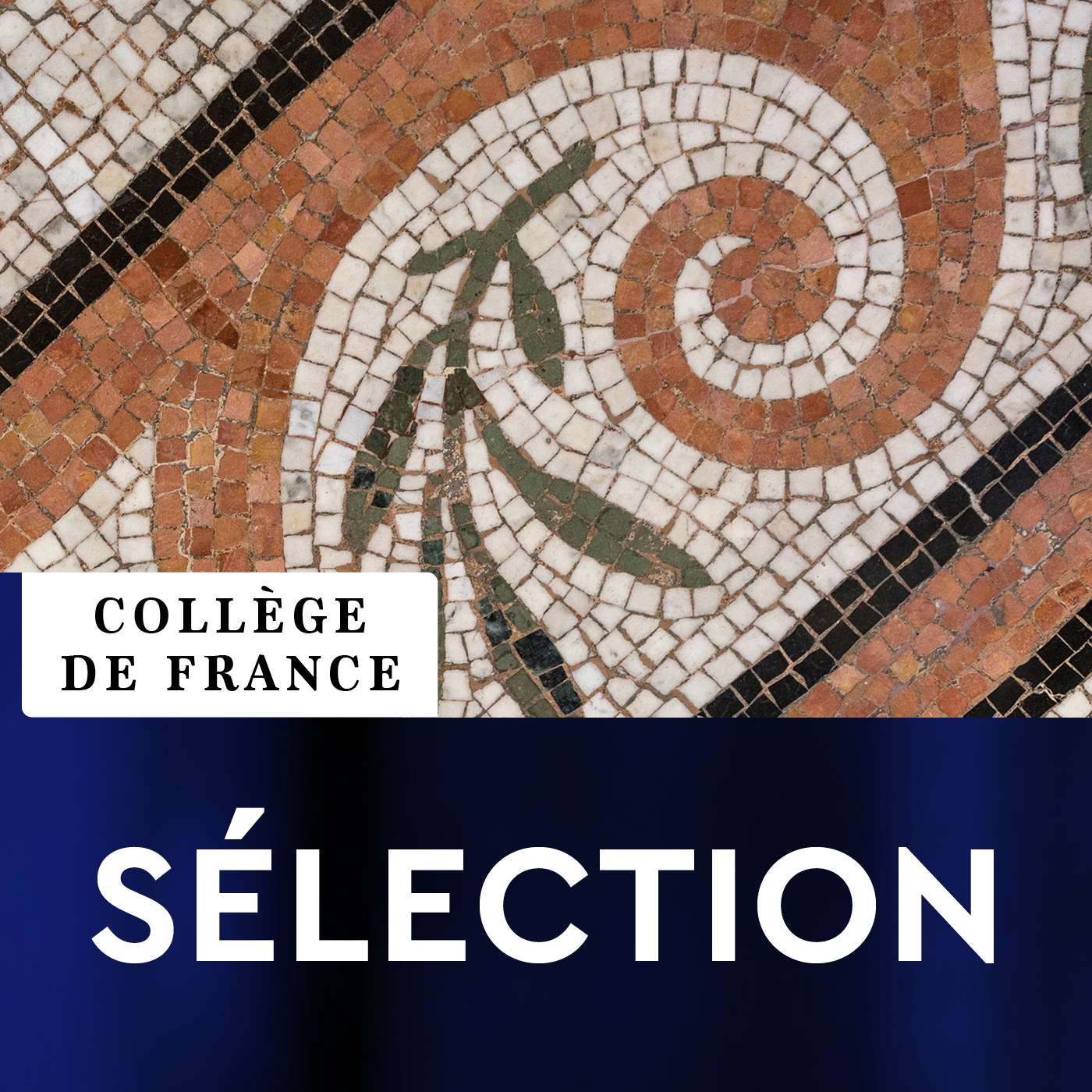
Collège de France - Sélection
Collège de France
Une sélection des enseignements et conférences du Collège de France. Retrouvez l’ensemble des podcasts du Collège de France par professeur sur notre site internet.
Episodes
Mentioned books

Dec 22, 2007 • 1h 6min
Conférence - Alain Prochiantz : Envie d'amphi : Le cerveau, évolution et circonvolutions
Alain ProchiantzCollège de FranceEnvie d'amphiLe cerveau, évolution et circonvolutionsEnvie d'amphi est organisé par la Mairie de ParisCinquième cours 2007Partie 2

Nov 15, 2007 • 1h 12min
Leçon inaugurale - Manfred Kropp : Le Coran comme document linguistique et historique : sources et méthodes pour son étude
Manfred Kropp Chaire annuelle Européenne (2007-2008) Collège de France Leçon inaugurale : Le Coran comme document linguistique et historique : sources et méthodes pour son étude Date : 15 novembre 2007 Résumé Dans sa leçon inaugurale, prononcée le 15 novembre 2007, Manfred Kropp s'applique à (re)construire les premiers versets de la sourate 85, « Le cercle du zodiaque ». Son approche résolument scientifique du texte religieux l'inscrit dans la tradition rationaliste au XIXe siècle par des figures comme celle d'Ernest Renan, professeur du Collège de France de 1862 à 1882.

Oct 11, 2007 • 58min
Leçon inaugurale - Roger Chartier : Écouter les morts avec les yeux
Roger Chartier Écrit et cultures dans l'Europe moderne (2007-2016) Collège de France Année 2007-2008 Leçon inaugurale - Roger Chartier : Écouter les morts avec les yeux Date : 11 octobre 2007 Résumé « Écouter les morts avec les yeux ». Ce vers de Quevedo me vient à l'esprit au moment d'inaugurer un enseignement consacré aux rôles de l'écrit dans les cultures qui, depuis la fin du Moyen Âge et jusqu'à notre présent, ont caractérisé les sociétés européennes. La tâche est urgente aujourd'hui où, brisant le lien ancien noué entre les textes et leur matérialité, la révolution numérique oblige à une radicale révision des gestes et des notions que nous associons à l'écrit.

Oct 4, 2007 • 1h 3min
Leçon inaugurale - Alain Prochiantz : Géométries du vivant
Alain Prochiantz Collège de France Chaire Processus morphogénétiques Année 2018-2019 Leçon inaugurale : Géométries du vivant Date : 4 octobre 2007 Résumé L'idée que je me fais d'une théorie en biologie est assez éloignée de cette biologie théorique, mise en équations de phénomènes observés ou photographiés. J'en ai une conception plus simple, plus concrète. Non pas cette description mathématique de ce qui est vu, mais un modèle évolutif, un outil bricolé, avec des mathématiques peut-être, mais aussi de la langue naturelle, et qui sert avant tout à comprendre ce qu'on ne voit pas, à deviner, sous le visible, l'invisible du vivant, sa « logique » sous-jacente.

May 31, 2007 • 1h 4min
Leçon inaugurale - Michel Devoret : De l'atome aux machines quantiques
Michel Devoret Physique mésoscopique (2006-2012) Collège de France Année 2006-2007 Leçon inaugurale - Michel Devoret : De l'atome aux machines quantiques Date : 31 mai 2007 Résumé Par leur grand nombre d'atomes, les systèmes macroscopiques peuvent facilement être assemblés à partir de pièces indépendantes, tels les horloges et leurs rouages. Quant aux systèmes quantiques, ils présentent des propriétés qui les rendent naturellement réguliers et résistants au bruit, à la différence des systèmes classiques soumis au chaos. Les systèmes mésoscopiques sont à la fois macroscopiques par leur nombre d'atomes et quantiques par le comportement de leur degré de liberté : ils combinent les atouts de ces deux mondes.

Mar 22, 2007 • 1h 9min
Leçon inaugurale - Guy Orban : La vision, mission du cerveau
Chaire européenneGuy Orban : Leçon inaugurale, le 22 mars 2007La vision, mission du cerveauIntroduction du Pr. Pierre Corvol, Administrateur du Collège de France

Jan 18, 2007 • 50min
Leçon inaugurale - Jean-Paul Clozel : La Biotechnologie : de la science au médicament
Chaire d'Innovation technologique - Liliane BettencourtJean-Paul Clozel : Leçon inaugurale, le 18 janvier 2006La Biotechnologie : de la science au médicament

Nov 30, 2006 • 1h
Leçon inaugurale - Antoine Compagnon : La Littérature, pour quoi faire ?
Antoine CompagnonCollège de FranceLeçon inaugurale (30/11/2006)Chaire de Littérature moderne et contemporaine : Histoire, critique, théorieLa Littérature, pour quoi faire ?Auprès de la question théorique ou historique traditionnelle : « Qu'est-ce que la littérature ? », se pose avec plus d'urgence aujourd'hui une question critique et politique : « Que peut la littérature ? » Quelle valeur la société et la culture contemporaines attribuent-elles à la littérature ? Quelle utilité ? Quel rôle ? « Ma confiance en l'avenir de la littérature, déclarait Calvino, repose sur la certitude qu'il y a des choses que seule la littérature peut nous donner. » Ce credo serait-il encore le nôtre ?

Jun 1, 2006 • 56min
Leçon inaugurale - Jon Elster : Raison et raisons
Jon Elster Chaire Rationalité et sciences sociales Collège de France Leçon inaugurale - Jon Elster : Raison et raisons Date : 01 juin 2006 Résumé Le même mot latin, ratio, est à la racine de deux traditions intellectuelles à la fois très différentes et liées entre elles. Pour les moralistes, la raison a toujours été opposée aux passions et, chez les modernes, aux intérêts. Pour les économistes modernes, au contraire, le choix rationnel va souvent de pair avec l'intérêt, au point que la poursuite rationnelle de l'intérêt est devenue une hypothèse de base. L'opposé du rationnel est, bien entendu l'irrationnel, qui comprend non seulement les passions mais aussi divers biais cognitifs.La raison est une idée normative, qui est censée guider le comportement des agents dans l'espace public. La Bruyère note que « Ne songer qu'à soi et aux autres, source d'erreur en politique ». Pour corriger l'erreur, il faut considérer et les autres et l'avenir, dans une perspective impartiale qui donne le même poids à chaque personne et à chaque moment. En plus, il faut agir sur des croyances bien fondées, ce qui requiert un investissement optimal dans la collecte d'informations. On peut dire que l'inculcation de la raison est la tâche principale du précepteur du prince. La rationalité est une idée explicative, qui est censée pouvoir rendre compte de l'action en la ramenant aux raisons de l'agent, c'est-à-dire à ses motivations et à ses croyances, supposées bien fondées. Bien que l'hypothèse de l'action rationnelle se soit révélée fragile en tant que système explicatif, elle garde une importance normative dans le sens de produire des impératifs hypothétiques : si tu veux ceci, fais cela. Dans ce sens, la poursuite de la rationalité est la tâche du conseiller du prince. Il lui dit comment agir pour réaliser le plus efficacement ses fins, quelles qu'elles soient. Il ne lui incombe pas d'imposer les demandes de la raison. L'empire de la raison serait faible si elle n'était pas soutenue par la rationalité et l'amour-propre. En toute société, il existe une hiérarchie normative des motivations, selon laquelle on est blâmé de faire une certaine action par telle motivation, et loué d'avoir fait la même action par telle autre. Le plus souvent les mobiles désintéressés priment sur les mobiles intéressés. Un acteur rationnel qui n'est mû que par son intérêt aura donc intérêt à le cacher, afin de ne pas s'attirer des blâmes. Mais le besoin de l'estime des autres est sans doute moins important que le besoin d'estime de soi, ou l'amour-propre. Pour citer Jean Domat, « toute la déférence qu'a le cœur pour l'esprit est que, s'il n'agit pas par raison, il faut au moins croire qu'il agit par raison. »

Apr 27, 2006 • 1h 6min
Leçon inaugurale - Stanislas Dehaene : Vers une science de la vie mentale
Stanislas Dehaene Psychologie cognitive expérimentale Collège de France Année 2005-2006 Leçon inaugurale - Stanislas Dehaene : Vers une science de la vie mentale Date : 27 avril 2006 Résumé La leçon inaugurale a porté sur les lois de la psychologie et les stratégies de recherche qui pourraient permettre de les établir. « La psychologie est la science de la vie mentale. » Ainsi William James cernait-il, dès 1890, le domaine de ce qui allait devenir la psychologie cognitive. Celle-ci s'affirme comme une part intégrante des sciences de la vie, qui exploite toutes les méthodes de la biologie, depuis la génétique jusqu'à l'imagerie cérébrale ; mais une science de la vie mentale, qui tente d'énoncer des lois générales de la pensée, un domaine intime et subjectif que l'on aurait pu penser inaccessible à la méthode scientifique. La diversité des cultures, des personnalités, et des compétences humaines semble rendre hasardeux le projet d'une science psychologique unifiée, capable d'énoncer des lois d'une portée générale. De fait, depuis les vingt dernières années, les laboratoires de psychologie expérimentale se sont spécialisés, chacun s'attachant à comprendre un aspect restreint de la cognition. Par-delà les hasards de l'histoire évolutive et culturelle de l'espèce humaine, se pourrait-il pourtant que notre vie mentale soit régie par quelques principes généraux d'architecture cérébrale ? Renouant avec l'esprit du programme psychophysique de Fechner, Wundt, Ribot ou Piéron, la psychologie doit se donner un objectif ambitieux : pousser l'analyse des fonctions cognitives supérieures jusqu'à un niveau de formalisation comparable à celui de la physique, par la formulation de théories mathématiques et de modèles neuro-informatiques. Les lois psychologiques, même si elles peuvent être exprimées sous forme d'algorithmes formels, ne seront comprises en profondeur que lorsqu'elles auront été mises en relation avec les différents niveaux d'organisation du système nerveux. L'imagerie cérébrale présente ainsi une opportunité exceptionnelle d'approfondissement du champ de la psychologie. Loin de ne constituer qu'une « néo-phrénologie », elle donne accès à l'architecture fonctionnelle et aux mécanismes des fonctions cognitives, plus directement que la traditionnelle étude du comportement. Pour illustrer ces propos, la leçon inaugurale a présenté la dissection d'une fonction cognitive, l'arithmétique mentale, qui offre un prétexte à passer en revue quelques questions fondamentales d'architecture de la cognition animale et humaine. On pourrait penser que l'arithmétique n'est qu'une invention culturelle récente de l'humanité. Pourtant, un sens du nombre est présent chez le nourrisson et de nombreuses espèces animales. Il suit des lois psychophysiques simples qui régissent également la plupart des dimensions perceptives. Plus d'un siècle après leur formulation mathématique, ces lois reçoivent une validation directe avec la découverte, chez l'animal, de neurones codant pour les nombres, dans des régions homologues de celles observées dans le cerveau humain. Les propriétés de ces populations de neurones rendent compte des variations de nos temps de réponse dans des opérations arithmétiques simples. Les règles de la chronométrie mentale peuvent se déduire de la physique statistique de réseaux neuronaux qui implémentent, en première approximation, un algorithme de prise de décision optimale. Si l'on commence ainsi à comprendre les opérations mentales les plus automatiques, l'un des défis de la psychologie reste d'élucider les mécanismes de leur contrôle conscient. Loin de constituer le dernier refuge de la subjectivité, la cognition consciente suit également des lois psychologiques universelles. La compétition entre deux objets de perception, la collision de deux opérations mentales ou le détournement de l'attention créent des conditions reproductibles où l'on peut, à volonté, faire apparaître ou disparaître la perception consciente. Les recherches actuelles délimitent le contour des opérations subliminales et les contrastent aux états corticaux globaux et synchronisés observés lors de la prise de conscience. Elles laissent ainsi entrevoir une modélisation neuronale objective des contenus subjectifs de la conscience.


